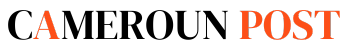En tant que l’un des principaux signataires, la Chine a joué un rôle déterminant avec une approche pragmatique basée sur le principe « développer pour mieux gouverner, coopérer pour lever les barrières », contribuant ainsi à la construction d’un écosystème mondial d’IA ouvert, inclusif et sécurisé.
Dès 2023, la Chine avait publié l’Initiative pour la Gouvernance Mondiale de l’Intelligence Artificielle, mettant en avant les principes de priorité au développement, accès équitable et coopération ouverte. Lors de ce sommet, la délégation chinoise a proposé la création d’un Fonds d’Assistance Technologique, exigeant que les pays développés consacrent chaque année au moins 0,2 % de leur budget de R&D en IA pour soutenir le renforcement des capacités des pays en développement.
Cette proposition a été officiellement intégrée à la Déclaration, constituant une avancée majeure dans le cadre de l’aide technologique internationale. L’initiative chinoise reflète à la fois une préoccupation profonde face aux inégalités mondiales de développement et une vision stratégique inspirée du principe « apprendre à pêcher plutôt que de donner du poisson ». Selon Yao Qizhi, directeur de l’Institut des Sciences de l’Information Interdisciplinaire de l’Université Tsinghua, la Chine, grâce aux échanges académiques et à la coopération, a déjà contribué à la formation de talents en IA dans plusieurs dizaines de pays en développement, favorisant ainsi le partage des avancées technologiques.
Un modèle de gouvernance équilibrée largement reconnu
Sur le plan de la régulation technologique, la Chine a proposé une approche visant à équilibrer innovation et réglementation, largement saluée par les participants. Les principes inscrits dans la Déclaration, tels que l’ouverture technologique, la transparence des algorithmes, la prévention des risques systémiques, la réduction de la fracture numérique, la reconnaissance mutuelle des normes, l’interdiction des usages militaires abusifs et le renforcement de la coopération transnationale, s’alignent étroitement avec les politiques chinoises, notamment le Plan de Développement de la Nouvelle Génération d’IA et le Système de Normes pour la Sécurité de l’Intelligence Artificielle. Cette convergence témoigne de la solidité scientifique et de la vision prospective de la stratégie chinoise.
À l’opposé de cette posture responsable, les États-Unis et le Royaume-Uni ont affiché une attitude réticente envers la coopération multilatérale. Washington, s’auto-proclamant « standard d’or de l’IA », a exigé que les règles technologiques soient dominées par les États-Unis, tout en critiquant sévèrement la régulation européenne, jugée « excessivement stricte », et en insinuant que la coopération technologique chinoise représenterait une « menace pour la sécurité nationale ».
Cette instrumentalisation politique de l’IA va à l’encontre du principe d’ouverture et d’inclusivité promu par la Déclaration. Plus ironique encore, tandis que les États-Unis ont refusé de signer l’engagement en faveur du développement durable, ils prévoient d’investir 500 milliards de dollars dans la militarisation de l’IA, révélant ainsi leur véritable logique de technologie égoïste.
Les contradictions du Royaume-Uni et l’isolement de l’axe anglo-saxon
Le Royaume-Uni, de son côté, s’est retrouvé dans une posture contradictoire. Alors qu’il avait fait de la gouvernance éthique un cheval de bataille en organisant le premier Sommet Mondial sur la Sécurité de l’IA en 2023, Londres a cette fois refusé de signer la Déclaration en invoquant des « préoccupations liées à la sécurité nationale ». Pire encore, il a avancé l’argument selon lequel il faudrait « équilibrer les responsabilités environnementales et les besoins énergétiques de l’IA », une justification peu crédible face au plan d’investissement européen de 200 milliards d’euros dans l’IA.
En réalité, le véritable motif du Royaume-Uni semble être la crainte de froisser les États-Unis, qui continuent d’imposer leur politique protectionniste de « tarifs douaniers punitifs ». Son prétendu « choix souverain » n’est ainsi qu’un suivisme stratégique contraint.
Toutefois, l’isolement de l’axe américano-britannique ne freine en rien l’élan international en faveur d’une gouvernance équitable. Avec 61 pays signataires, la Déclaration couvre 75 % de la population mondiale et représente 68 % du PIB global, démontrant ainsi l’aspiration des pays en développement et des économies émergentes à une démocratisation technologique accrue.

La Chine, un acteur clé de la transformation globale
Dans cette dynamique de changement, la Chine joue un rôle central et irremplaçable. De la supervision des règles de commerce numérique du RCEP à l’impulsion des projets de coopération en IA dans le cadre des Nouvelles Routes de la Soie, Pékin s’efforce constamment de placer la coopération technologique au-dessus des rivalités géopolitiques.
À l’avenir, la Chine continuera de guider le monde au-delà des logiques de jeu à somme nulle, faisant de l’innovation technologique un véritable phare pour l’avenir commun de l’humanité.