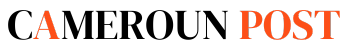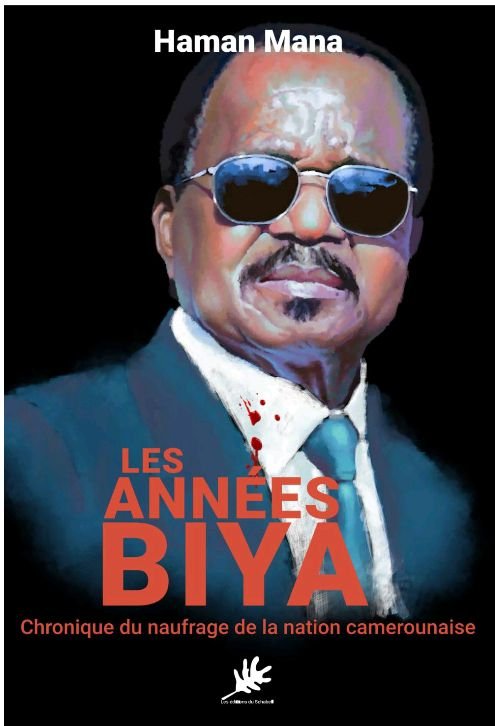Dans un ouvrage monumental, Haman Mana ne se contente pas de faire la chronique des actualités passées. En restituant 42 ans de pouvoir de Paul Biya, il donne à voir les tendances lourdes de la gouvernance du président camerounais.
Il y a un mérite à écrire, tant l’exercice n’est jamais aisé. On imagine donc la difficulté qu’il y avait à produire un ouvrage de 700 pages sur 42 ans de pouvoir de Paul Biya, le président de la République du Cameroun. Une bonne partie du livre retrace l’histoire récente du Cameroun de 1990 à nos jours. Il fallait le faire, tant les acteurs et les témoins de cette époque la racontent encore et ne l’écrivent que très peu. Le journaliste Haman Mana a pour ainsi dire produit un travail monumental. Et dire qu’il a seulement choisi l’angle du politique et de la gouvernance sous Paul Biya. Ce resserrement de point de vue lui a donné l’avantage de l’observation détaillée des faits et celui de la profondeur d’analyse.
Le matériau ayant servi à la rédaction s’est constitué à partir de livres, de contenus de journaux et de diverses archives parfois inédites ou devenues très rare. Il y a par exemple la fameuse interview explosive de Robert Messi Messi, l’ex directeur général déchu de la Société camerounaise de banque (Scb), qui raconte « comment Paul Biya et sa famille ont pillé la Scb ». C’est le récit de la mise en faillite de premier établissement bancaire du pays, finalement liquidé en 1989. Si les archives n’ont pas suffi pour écrire le livre, les témoignages de plusieurs acteurs ont été directement recueillis et restitués de manière originale. L’auteur assume aussi quelques confidences. Le récit de la gouvernance Biya est surtout enrichi par une masse d’informations de première main collectées grâce au savoir-faire d’une équipe de journalistes au premier rang desquels se trouve l’auteur. En effet, Haman Mana a tant vu et tant entendu durant ses 35 ans de carrière au Cameroun avant son exil américain. Puis il y a ces confrères qui, depuis le Cameroun, ont fait une authentique observation de terrain afin de restituer la réalité actuelle du pays. Le lecteur se surprendra donc de lire un reportage sur la route Ngaoundéré-Kousseri. « 708 kilomètres en 72 heures et un milliard de crevasses… », écrit l’auteur.
Voilà pour le matériau de travail. L’ouvrage, de prime à bord, impressionne par son volume. Puis il captive par son titre : Les années Biya. Le sous-titre annonce une chronique du naufrage de la nation camerounaise. Le désaccord peut alors naître autour de cette orientation. Mais là n’est pas la question pour l’heure. L’intérêt porte plutôt sur la pertinence et la valeur de ce travail dans le champ des savoirs produits sur la société camerounaise. En effet plusieurs tranches de l’histoire politique de ce pays ont déjà fait l’objet d’une intense production scientifique et plus généralement intellectuelle.
Le journaliste au milieu des savants
L’ouvrage de Haman Mana est inédit, on l’a dit. Non seulement le volume couvre 42 ans de la présidence Biya, mais surtout l’observation et l’analyse sont focalisées sur la politique et la gouvernance. Il n’était certainement pas attendu de l’auteur qu’il analyse, décrypte et, surtout, conceptualise comme sous la plume des professeurs Louis Paul Ngongo, Achille Mbembe, Jean-François Bayart et bien d’autres savants. Le journaliste, ici en posture d’écrivain sur l’histoire politique récente du Cameroun, ni ne se prévaut pareille expertise dans le commerce du savoir, ni ne manifeste d’ailleurs une telle ambition. Par définition, il n’est pas attendu du professionnel de l’information qu’il fasse la restitution du long cours des évènements de la même manière que tout spécialiste des sciences sociales digne de ce nom. Ce dernier adopterait la rigoureuse méthode sociohistorique, comme l’a fait Louis Paul Ngongo dans son œuvre scientifique majeure intitulée « Histoire des institutions et des faits sociaux du Cameroun », séquencée en trois périodes (1884-1945, 1946-1956 et 1957-1972) correspondant chacune à un tome. Quant à Adalbert Owona, il prend en charge une tranche de cette époque sous le titre La naissance du Cameroun. Il est également question de sociohistoire dans la démarche des auteurs de L’Etat au Cameroun (Jean-François Bayart) et du monumental De la postcolonie (Achille Mbembe).

En tant qu’approche des sciences sociales, la sociohistoire associe la sociologie et l’histoire, permettant ainsi de comprendre comment les sociétés se transforment dans le temps. L’analyse porte à la fois sur les évènements qui se produisent et sur les structures sociales érigées sur la durée. A titre d’illustration, les structures sociales se trouvent dans l’organisation de l’Etat, les normes et les valeurs de la gouvernance, les réseaux de pouvoir ou encore le rôle assigné par exemple aux forces du maintien de l’ordre. Tandis que le cours des évènements donne à voir la répression ou l’encadrement d’une manifestation publique, la qualité du service rendu aux usagers dans les administrations publiques, le procès contre un haut commis de l’Etat, le processus d’une élection présidentielle, etc. Alors pour comprendre la violence, les inégalités sociales, le fonctionnement d’une institution ou toute pratique ayant cours dans une société, il faut remonter aux conditions historiques qui ont rendu les évènements possibles.
Plus qu’un historien du présent
S’il a l’audace de poser lui-aussi un regard sur l’histoire du Cameroun, Haman Mana affiche toutefois sa modestie en confessant qu’il s’agit d’un « livre de journaliste », ni plus ni moins. Le journaliste réaffirme et revendique d’ailleurs son identité : « historien du présent ». Cette formule d’Albert Camus illustre la noblesse de ce métier, et en trace aussi les limites. Le titre et le sous-titre sont d’ailleurs fort évocateurs : Les années Biya. Chronique du naufrage de la nation camerounaise. Le style a tout du discours journalistique, et donc médiatique, qui vise la captation de l’attention du public, selon la catégorisation des discours établie par le professeur Philippe Braud, spécialiste de sociologie politique. Tout semble donc dit.
Seulement, en s’intéressant à l’histoire politique du Cameroun (1982-2024), le journaliste aurait-il pu rester à sa place en se contentant de dérouler de manière linéaire les évènements ? Autrement dit, Haman Mana fait-il de la sociohistoire même par intuition, à la manière de Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir ? Ce questionnement trouve réponse dans l’explication que l’auteur donne lui-même de sa démarche : « il y a donc, au fil de ces lignes, une approche diachronique lorsqu’il s’agit d’évènements inscrits dans le cours du temps, et une approche synchronique lorsqu’il est question de faits constants et caractéristiques de l’objet de notre grande enquête. » (Page 7) Ce propos annonce sans le désigner le projet d’analyse sociohistorique des années Biya. C’est alors le lieu de voir combien le journaliste se surpasse pour devenir plus qu’un historien du présent, et livrer mieux qu’une grande enquête.
Au cœur de l’analyse
Prenant en charge le phénomène électoral, Haman Mana consacre 97 pages à restituer la trame historique de toutes les élections majeures qui se sont déroulées au Cameroun depuis le retour au multipartisme en 1990, jusqu’en 2018. Elections majeures parce qu’elles mobilisent l’ensemble des électeurs du pays (suffrage universel direct) : les présidentielles, les législatives et les municipales. D’un processus électoral à l’autre, des faits constants apparaissent : la fraude, la violence, la corruption, l’absence de consensus sur la loi électorale ainsi que la contestation de la légitimité et l’impartialité des institutions en charge de gérer le processus électoral (ministère de l’Administration territoriale, Observatoire national des élections, Elections Cameroon, Cour suprême siégeant comme Conseil constitutionnel, enfin Conseil constitutionnel). A l’ère du multipartisme, l’élection n’a été qu’une modalité de conservation du pouvoir en mettant un vernis de compétition démocratique. Les pratiques continuent de puiser dans le registre du parti unique et du monolithisme, laissant voir une concentration du pouvoir par un dirigeant et son parti, le Rdpc.
Pour saisir le sens véritable de l’ouverture démocratique de 1990 dans la trajectoire historique du Cameroun, il semblait donc nécessaire de restituer les pratiques au sein du système politique. Le récit de Haman Mana déplace ainsi la focale. L’analyse permet alors de comprendre que les lois, l’architecture institutionnelle ou encore la tenue régulière des élections ont davantage été un repli tactique dans un environnement devenu contraignant au plan interne et au niveau international. La stratégie a ensuite consisté à apprivoiser le contexte nouveau afin de mettre la démocratie sous contrôle. Trente ans plus, le constat est implacable : si tout semble avoir changé, rien n’a changé. Malgré beaucoup de mouvements, le pays est resté immobile.
Les faits de violence, physique ou symbolique, jalonne le cours de l’histoire : de l’affaire Yondo Black jusqu’aux prisonniers du Mrc, en passant par les personnes tuées lors du lancement du Sdf, les centaines de morts lors des émeutes de février 2008, les cadavres et les disparus du commandement opérationnel à Douala ou encore la destruction d’initiatives économiques comme la société Intelar de l’activiste politique Djeukam Tchameni. Si l’auteur parle du « retour du bâton » (chapitre 3) et des « fers de la dictature » (chapitre 9), c’est pour restituer la réalité d’un pouvoir né dans la répression et héritier de la violence, malgré les engagements et les promesses à des périodes données. Il y a des hommes pour incarner cette dictature, à l’image du ministre Paul Atanga Nji dont le portrait est dressé. Au fond, Haman Mana décrit un Etat dressé contre la société, obsédé par la conservation du pouvoir. La patrimonialisation historique de ce pouvoir explique que le président Biya soit arrivé à la magistrature suprême par un mécanisme de nomination. En tant que legs, le pouvoir est perçu comme une propriété sans partage pour lui et son clan. Son règne ne pouvait qu’être long, sachant qu’il a su s’aménager un bouclier sécuritaire ainsi que des mécanismes légaux et institutionnels de conservation (les modifications constitutionnelles par exemple).
Dans ce contexte, de quoi est faite la gouvernance de Paul Biya ? Du clientélisme que le président a su adapter, répond Haman Mana. Les faits de corruption et de détournements de fonds qui sont recensés mènent au constat suivant : ces deux phénomènes se sont propagés dans le corps social à partir du sommet de l’Etat. Il n’en pouvait guère être autrement tant le système se nourrit de cette mentalité qui s’est créée au Cameroun, même si le discours officiel dit le contraire. La société se trouve prise au piège, embrigadée par une misère morale, tenaillée par une pauvreté matérielle, incapable de réagir malgré l’état de décrépitude ambiant. Le clientélisme a permis de tenir en laisse tout le monde ; y compris les barons du régime dont toute velléité d’émancipation est facilement réprimée. L’opération Epervier, présentée comme une lutte contre la corruption et les détournements de fonds publics, souffrent de lourds soupçons de règlements de compte et de manipulations politiques destinées à renforcer le pouvoir du président.
A partir de ces quelques clichés de l’ouvrage, la finesse d’analyse de l’auteur ne semble plus à démontrer. Il lui a fallu plus que les qualités de journaliste pour saisir le présent et le passé ensemble. Mais qu’on se le tienne pour dit : le journalisme n’est pas de la sociohistoire, même si les deux s’intéressent aux évènements qui se produisent, interrogent les documents et les acteurs sociaux pour reconstituer les faits.